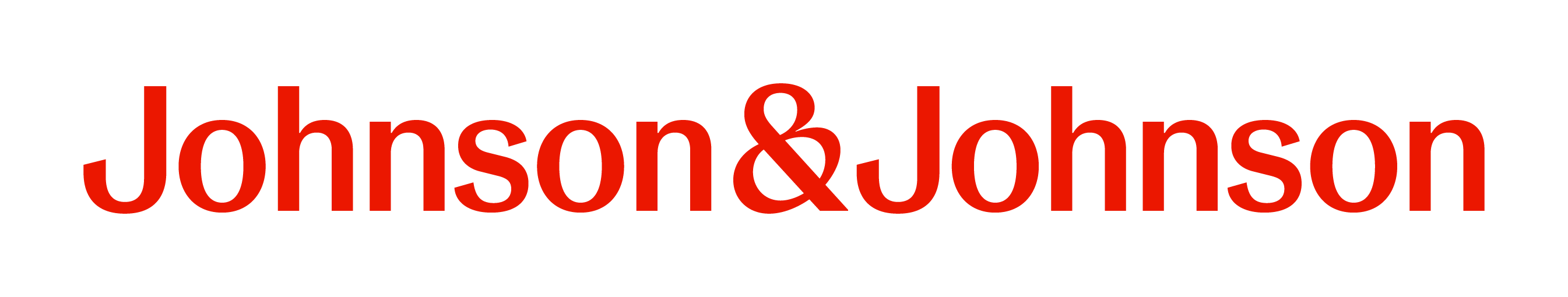Dans une large étude de cohorte danoise, les patients atteints de MICI diagnostiqués après 60 ans étaient largement moins exposés aux traitements immunosuppresseurs et biologiques comparativement aux patients diagnostiqués plus jeunes, y compris après 2 cures de corticoïdes. Le degré de fragilité des personnes âgées n’expliquait pas entièrement ces différences [14]. En effet, à sévérité égale, les personnes âgées atteintes de MC et de RCH sont plus souvent sous-traitées que les adultes jeunes,ce qui suggère que les décisions de traitement sont davantage influencées par l’âge que par la sévérité de la maladie [3]. Pourtant, les principes du traitement des MICI chez les personnes âgées devraient être similaires à ceux de la population plus jeune, en tenant compte des défis spécifiques mentionnés plus haut (figure 1).

Figure 1. Challenges spécifiques liés au patient et à la maladie dans la prise en charge des MICI chez les personnes âgées, d’après [3].
Paradigme thérapeutique
Les objectifs à atteindre devraient théoriquement être les mêmes quel que soit l’âge du patient (rémission clinique et endoscopique, normalisation des biomarqueurs). Les stratégies thérapeutiques pour obtenir ces résultats sont dictées, outre les modalités de rembourse- ment, par le type de MICI, sa sévérité, et la présence éventuelle de manifestations extradigestives [3].

Plus que l’âge réel du patient, c’est l’âge physiologique que doivent considérer les médecins prenant en charge ces patients, en mettant en balance les bénéfices et les risques de la mise en route d’un traitement immunomodulateur. Ainsi, les médecins peuvent choisir de tolérer une activité endoscopique légère du fait du faible risque de complications à long terme, résultant d'une durée de vie plus courte par rapport à la population plus jeune [3]. Bien sûr, la discussion avec le patient est primordiale, dans l’objectif d’une décision médicale partagée.
Efficacité et tolérance des traitements médicamenteux chez le sujet âgé
L’efficacité des traitements utilisés dans les MICI chez les personnes âgées est similaire à celle observée chez les patients plus jeunes [15]. En revanche le profil de tolérance diffère selon les molécules et doit être pris en compte selon l’âge physiologique et les comorbidités [15].
Des biothérapies avec un profil de tolérance acceptable pourraient être proposées aux sujets âgés. Le clinicien peut s’appuyer sur des recommandations et sur les RCP des différents médicaments pour évaluer l’alternative thérapeutique la plus pertinente pour ces patients vulnérables.
Place de la chirurgie chez le sujet âgé
Les études observationnelles indiquent un taux de chirurgie plus élevé chez les patients âgés atteints d’une MICI qu’en population plus jeune, particulièrement en cas de RCH [5, 8]. L’échec du traitement médical constitue l’indication prédominante, mais les formes sévères d’infection à Clostridioides difficile et le CCR sont aussi des indications fréquentes [16]. Un tiers des patients âgés atteints de MICI souffre d’au moins une complication postopératoire [16]. La moitié des complications précoces sont des infections sévères [16]. La chirurgie d'urgence et la dénutrition sont les principaux facteurs d’une évolution défavorable [16]. En cas de colite aiguë grave, le recours à la chirurgie doit donc être envisagé plus précocement que chez le sujet jeune. En réalité, l’âge ne constitue pas en lui-même une contre-indication à la chirurgie de MICI, mais il est indispensable de tenir compte de l’âge physiologique du patient, de ses comorbidités, et de son statut nutritionnel [16]. Avant la réalisation d’une anastomose iléo-anale, il sera nécessaire d’évaluer au préalable les fonctions sphinctériennes, la motricité et les fonctions cognitives, car une dégradation du résultat fonctionnel est plus fréquente chez les sujets âgés.
Surveillance et vaccinations [17]
Il ne faut pas négliger l’aspect préventif de la prise en charge d’une MICI en population âgée. Pour le dépistage du CCR, les consignes doivent tenir compte des possibilités thérapeutiques en cas de coloscopie pathologique (absence de contre-indication à une chirurgie curative, espérance de vie permettant d’espérer un bénéfice d’un tel dépistage).
Enfin, le suivi du calendrier vaccinal est essentiel et doit être adapté en fonction de l’état de santé du patient. Il est important de revoir régulièrement le statut vaccinal du patient en tenant compte de l’évolution de sa santé et du contexte épidémiologique. [17]